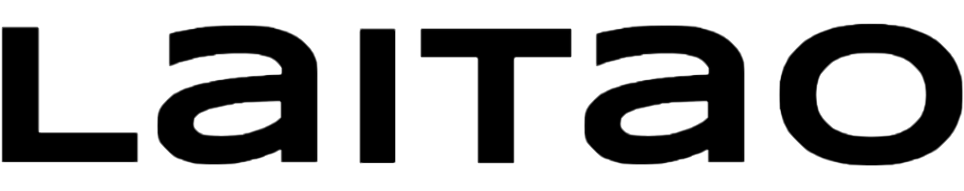Les entreprises traditionnelles peuvent-elles devenir des plateformes digitales ?
D’une certaine manière, la crise du COVID-19 a été un excellent outil de passage aux rayons X de l’ensemble de l’économie française. Il y avait ceux qui y arrivaient et ceux qui n’y arrivaient que péniblement. Au sein des entreprises tertiaires, certaines sont parvenues à faire travailler leurs salariés de chez eux tandis que d’autres, dont des administrations publiques, ont eu toutes les peines du monde à mettre cela en place. Les responsables de ces organisations se sont soudainement rendu compte qu’avoir des systèmes d’informations convergents, comprenant APIs, applications virtualisées, CRM unifiée, étaient autant de points déterminants pour perdurer dans ce nouveau monde. Les entreprises qui s’en sont le mieux sorties sont, on le sait, celles qui ont été construites par et pour la révolution digitale, à commencer par Amazon, probablement l’acteur qui a, à un niveau global, le plus bénéficié de cette crise. Pour les autres, les acteurs traditionnels, il est peut-être temps de commencer à voir les choses un peu différemment.
Nous disposons désormais d’un recul d’une dizaine d’années à cet égard. En ce qui me concerne, j’ai accumulé près de 500 analyses (eCAC, digital ETI…) faites sur différentes entreprises sur près de 10 années. Lorsque l’on regarde dans le détail, on ne peut qu’admettre que d’importants changements ont été entrepris, les systèmes d’informations sont plus intégrés et convergents, l’intelligence artificielle n’est plus considérée comme un objet de spéculation mais bien comme un facteur opérationnel. Bien des entreprises ont mis en place de nouvelles formes organisationnelles, en conséquence de cette révolution numérique. Par exemple, les distributeurs ont unifié les canaux de vente digitaux avec les magasins physiques, les acteurs du monde de la banque ont mis en place des processus d’appréciation du risque (financier ou cyber) basés sur des systèmes de machine learning, etc.
Après d’importants efforts, on voit enfin des organisations de type devops se mettre en place, de même l’on voit des approches agiles dont le réel patron n’est plus le supérieur hiérarchique, mais bien le client. Tout cela est largement à saluer car les efforts pour induire ces changements sont significatifs et n’ont pu être faits que dans le temps long.
La question qui se pose néanmoins s’exprime en termes provocateurs : est-ce que ces entreprises peuvent réellement devenir des acteurs digitaux à part entière et, en particulier, peuvent-elles espérer bénéficier un jour des rendements croissants, graal de la startup ?
Il me semble que si l’on devait définir un premier obstacle majeur, il concernerait les talents. Il est remarquable d’observer que les acteurs traditionnels, CAC40 et ETI incluses, peinent à les attirer. A cet égard une anecdote : à l’occasion d’un cocktail, j’avais recroisé l’une des membres du comité de direction d’un grand groupe énergétique européen. Elle connaissait bien mon intérêt pour les enjeux de transformation digitale et notre conversation s’orienta naturellement sur les difficultés qu’il y avait à transformer une organisation pour lui faire prendre le pli de celles du XXIème siècle : après avoir évoqué l’inévitable mantra de l’agilité, l’importance du bien-être des collaborateurs et quelques autres banalités, elle me fit observer qu’il y a quelques décennies, son entreprise recrutait presque un cinquième des diplômés de l’école des Mines et de polytechnique, les meilleurs en général, là où aujourd’hui, ils peinent à en attirer seulement quelques-uns et, remarquait-elle, probablement plus les meilleurs. Elle ne faisait que faire là le même constant que celui des dirigeants des blue-chips - les plus importantes entreprises américaines : les meilleurs élèves de Stanford ou du MIT ne viennent plus travailler chez eux.
Cet aveu, nombreux ont été ceux qui me l’ont fait sous différentes formes, au sein du management des grands acteurs économiques français, et il est vraisemblable que la situation est la même aux États-Unis, en Chine comme partout ailleurs. La révolution digitale s’impose à tous et elle porte en elle une évidente rupture technologique ainsi que managériale. Il ne s’agit pas simplement d’être capable de construire des « innovations-centers » aux environnements colorés, muni de babyfoots, et autres facteurs d’agréments de même acabit, il s’agit de méticuleusement structurer une culture beaucoup plus entrepreneuriale, propice à l’innovation, à la prise de risque, à l’autonomisation des collaborateurs ; une culture où il faut savoir franchir la ligne jaune, travailler ensemble et être en même temps totalement individualiste, utiliser des masses de données et les valoriser d’une façon totalement inattendue et parler incomparablement plus souvent à son client qu’à son chef.
A l’heure de la révolution numérique et des startups, pourquoi donc les jeunes diplômés iraient-ils travailler dans des entreprises où les technologies informationnelles sont dépassées, la culture est celle d’un autre siècle et les projets consistent essentiellement à se battre pour se maintenir sur un marché qui est en décalage profond avec le monde qui vient ? Qui a une vocation pour faire du contrôle de gestion à la direction d’une chaine d’hypermarché à l’heure de l’économie circulaire, des market-places et de l’e-commerce ? Qui souhaite rejoindre un fabricant automobile devant encore réaliser 90% de sa transition, du moteur thermique vers l’électrique, et pour lequel le véhicule autonome n’est qu’une lointaine option ? Qui voudrait travailler dans une banque dont le souci premier semble être de respecter la réglementation interne et externe et de s’en prévaloir pour maintenir son activité, loin devant son souci d’innover ?
Ces signaux faibles n’ont rien d’anecdotiques ; ils sont avant-coureurs d’une mutation profonde. Depuis les années soixante-dix, les cabinets de recrutement effectuent des analyses afin d’analyser où vont les plus hauts potentiels. Sans coup férir, celles-ci permettent d’anticiper les secteurs qui vont durablement se développer et ceux qui sont en passe de banalisation. Par le passé, ce type d’approche avait mis successivement en avant des secteurs comme l’automobile, la publicité, l’aéronautique, la grande distribution, etc. Aujourd’hui, ces analyses mettent en évidence une désaffection pour un certain nombre de secteurs traditionnels et de façon concomitante, une montée en puissance des technologies informationnelles.
Il y a encore quelques années, les startups se battaient à armes inégales avec les grands groupes et même avec des entreprises traditionnelles plus petites. Moins bien financés qu’aujourd’hui, elles ne pouvaient se permettre d’offrir les salaires et les avantages en nature que l’on proposait aux jeunes postulants. Elles ne pouvaient non plus garantir une évolution de carrière rapide, dans la mesure où cette évolution était directement liée à leur propre développement, d’autant plus hypothétique que le taux d’échec de cette catégorie d’acteurs est longtemps resté particulièrement bas. Ce phénomène a contribué à largement masquer l’amplitude de la vague qui allait déferler sur les acteurs traditionnels.
Désormais c’est l’inverse qui prévaut. Et ce n’est pas que le salaire et les stock-options que ne parviennent pas à égaler les entreprises traditionnelles, c’est aussi le modèle de management, la culture. Car, même si les startups ne sont pas exemptes de défauts, elles ont largement refondé la pratique managériale et les facteurs culturels en vigueur dans les entreprises. Le fait même que l’un des termes les plus communs à la culture du code soit celle du « growth-hacking » en dit beaucoup. L’idée n’est plus de respecter des règles consensuelles, ou même consubstantielles, l’idée est de repenser l’ensemble des notions qui font une entreprise. Cela commence évidemment par le modèle d’affaire et le modèle opérationnel, mais partant de ces deux points concrets, cela s’étend à la façon dont on travaille, l’importance moindre que l’on porte à la culture du commandement, et l’importance supérieure que l’on accorde à l’expérience utilisateur.
Le choc est donc désormais là. Non seulement les grands groupes ne parviennent plus à recruter en sortie d’école, mais leurs meilleurs éléments les quittent dans une proportion qui n’a rien d’anecdotique. En deux années, un grand groupe aéronautique européen a perdu presque un quart de son état-major, presque tous partis travailler pour des entreprises nativement numériques ! Ces démissionnaires, s’ils souhaitent prendre des risques, monteront donc leur propre entreprise et ceux qui ne le souhaitent pas iront chercher de meilleurs salaires, un niveau de sécurité de l’emploi supérieur au sein des licornes, ou même de petites entreprises digitales qu’ils n’auront certes pas fondés mais qui leur éviteront les affres que presque tous fondateurs rencontrent lorsqu’ils ont par exemple des difficultés à payer les salaires à la fin du mois. Dans un monde stable, les grandes entreprises disposaient d’un avantage par rapport aux petites : elles bénéficient à plein de l’effet de taille pour remporter de grands marchés, pour acheter à meilleur prix, pour disposer de la meilleure recherche et développement, pour payer les meilleurs salaires et les meilleurs avantages en nature. Mais dans un monde en forte transition, ces avantages se retournent contre les acteurs traditionnels dont les systèmes d’informations, le modèle de management sont faits pour des organisations en silos, où l’agilité nécessaire à l’innovation radicale manque, alors même que les meilleurs éléments y sont affectés à la préservation des acquis. De fait, l’avantage compétitif est transféré à ceux qui peuvent mettre en œuvre les dynamiques de demain ; là où ceux qui souhaitent innover savent trouveront un contexte plus ouvert à des approches alternatives et potentiellement radicales ; là où les capitaux sont, dans une certaine mesure, plus abondants et plus appropriés à la prise de risque.